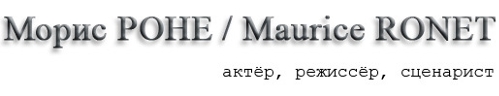Les hommes du temps présent
Maurice Ronet: Le secret de son charme
 Beaucoup de charme. Pendant un bon moment, je me demanderai: «Ce charme d'où vient-il?» Or, les miens, qui, par une série de circonstances, dues un peu au hasard, ont rencontré ces temps-ci Maurice Ronet, me l'expliqueront mieux.
Beaucoup de charme. Pendant un bon moment, je me demanderai: «Ce charme d'où vient-il?» Or, les miens, qui, par une série de circonstances, dues un peu au hasard, ont rencontré ces temps-ci Maurice Ronet, me l'expliqueront mieux.
— Il est grand et mince, avec des yeux bleus qui semblent regarder très loin, dira ma femme. Un air, tout à la fois, vulnérable et tendre.
Mon fils, après une longue conversation avec Ronet lors d'un dîner, me déclare:
— Tout ce qu'il dit est intéressant, qu'il parle de peinture, de musique, de voyages. Le cinéma, pour lui, ne représente pas un monde clos.
... Maurice Ronet, c'est l'acteur qui monte, et il monte vite et fort. En à peine deux ans, il a tourné «La Piscine», «Les Femmes», «Un peu, beaucoup, passionnément», «Raphaël ou le Débauché».
— Et maintenant, dit-il, je suis en plein tournage du nouveau film de Sergio Gobbi: «Les Falaises d'Etretat», avec Virna Lisi. Une belle histoire. J'y suis un coureur automobile, passionné de vitesse, dur avec les autres et sans concessions. Virna, elle est une femme libre et sans attaches. Un beau soir, elle me plaît. Mais venant à peine de me connaître, elle se refuse à moi. Alors je me passe carrément de son consentement. Enragée de colère, elle me poursuivra «pour me faire payer» ; peu à peu, elle me prendra dans ses rêts, car sa vengeance, c'est de m'obliger à l'aimer, je résiste, puis je craque. Sous le vent qui balaye les côtes, et en marchant sur les galets d'Etretat, nous nous apercevrons que, commencée dans la violence, notre aventure va, sans doute, se terminer par le bonheur. Une histoire optimiste.
— Ce sera à peu près le soixantième film dans lequel vous aurez tourné. Pour vingt années de carrière, ça donne une rudement belle moyenne. Pourtant, cette carrière est un peu en zigzag. Vous apparaissez, vous disparaissez. Et puis, vous êtes, tout à la fois, musicien, peintre, céramiste, romancier, scénariste, metteur en scène et acteur. Pour y voir clair, je vous propose de prendre, le plus simplement du monde, L’ordre chronologique.
— Mes parents étaient, tous les deux, acteurs de théâtre; on pense, généralement que le fait d'être «un enfant de la balle» détermine des vocations précoces. Ce ne fut pas mon cas. Sans doute parce qu'on a l'esprit de contradiction quand on a quinze ou dix-huit ans, je me sentais plus attiré par les arts plastiques et par la littérature que par les planches. Pourtant à l'âge de seize ans j'ai joué, auprès de mes parents, mon premier rôle, dans «Les Deux Couverts» de Sacha Guitry. Après le bachot, je suis entré au Conservatoire, dans la classe de René Alexandre, illustre sociétaire de la Comédie-Française. Ma formation théâtrale fut donc classique. Juste après la guerre, pourtant, je pensais toujours à une carrière de peintre. J'étais ami de Mathieu, de Dubuffet. J'ai exposé, et non sans succès. Ainsi j'ai vendu ma première toile 300 000 francs (anciens). Ça marchait bien et je vivais de mon art. Je fréquentais Saint - Germain-des-Près. Là Jacques Becker, en 1949, me fit faire mes débuts sur l'écran, dans «Rendez-vous de juillet».
— Qui fut une pépinière de futures étoiles !
— Eh oui ! Daniel Gélin y joua son premier grand rôle. Françoise Arnoul et Pierre Mondy y faisaient de la figuration. Jacques Fabbri tenait un petit rôle. Parmi les autres il y avait Brigitte Auber et Nicole Courcel, qui allait être, plusieurs fois ma partenaire au cinéma. Le sujet : Quatre copains qui partent en Afrique noire pour faire un reportage... Beau film ! Mais, un tournage avec Becker c'était une rencontre avec un être d'exception. Après lui, je fus donc plus réservé à l'égard d'autres metteurs en scène. D'ailleurs la peinture m'attirait à nouveau. Je continuais à exposer aux côtés de Dubuffet, de Hartung. Nous n'étions pas des peintres «abstraits»; nous étions des «non-figuratifs». J'ai également écrit deux romans, dont «Le Rapport» que je voudrais, un jour, tourner. Un homme devient jaloux de sa femme, et s'adresse à un ami pour la faire suivre par une agence. L'ami, ayant toujours considéré que ce mariage était bancal, prend sur lui de fausser les données du problème notamment dans le rapport de police qu'il mettra sous les yeux du mari. La femme, pour mieux écarter des soupçons injustifiés, s'enferrera, de plus en plus, dans le mensonge, alors qu'en vérité elle n'était coupable de rien.

— Vous racontez bien. Voilà deux fois que je m’en aperçois. Mon fils avait raison... Si je comprends bien, votre chevalet et votre plume ne vous laissaient guère de temps pour faire du cinéma, votre principale occupation. Cela dure quatre ou cinq ans, mais vous tournez néanmoins dans quelques films.
— Oui : «La Môme Vert-de-gris», par exemple, ou avec Yves Ciampi, «Un Grand Patron» et «Le Guérisseur». Puis «Les Aristocrates», avec Denys de la Pattellière, et d'autres. En somme, j'essaye de mener de pair les arts plastiques et l'écran. Mais je m'apercevrai, bien
tôt, qu'il est impossible de mener les deux de front. La peinture, ce n'est pas seulement très accaparant; elle exige, au surplus, une mentalité particulière. On peut être peintre et sculpteur: il y a même quelques exemples de génie; on ne peut pas être peintre et acteur. Bref, ayant été peintre, romancier et musicien (j'adore le piano et l'orgue), je me suis aperçu un jour que dans le cinéma je toucherais à la synthèse de tous mes goûts. De plus, cela flatte un côté de mon caractère qui est d'être attiré par l'Aventure. C'est, d'ailleurs, presque une affaire de génération. La mienne pour s'en sortir, a eu besoin de faire appel à un certain sens aventureux. Disons que c'est une génération sans archétype, qui ne peut pas être représentée par un seul visage ou une seule définition, et qui, de plus, pendant assez longtemps, a dû végéter sur elle-même.
— Bref, vers 1955, le cinéma vous prendra tout entier.
— André Michel me prend pour «La Sorcière». L'action se passe au sud de la Suède. Un ingénieur tombe sur une petite sauvageonne, soupçonnée de sorcellerie. Or, lui, c'est le cartésien parfait. D'où choc. La sauvageonne, c'était Marina Vlady, dont c'était le premier rôle important. Vint ensuite aux côtés de Jeanne Moreau «Ascenseur pour l'Echafaud», le film qui restera célèbre, de Louis Malle. Une fois de plus, je joue un personnage qui est un peu le transfuge d'une génération, c'est une peau qui ne me quittera plus guère, peut-être parce qu'à travers tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai toujours rencontré des gens du même âge que moi, préoccupés par les mêmes problèmes, et se posant à peu près les mêmes questions. Un jour, Roger Nimier (qui aurait été l'un de nos plus grands écrivains s'il avait vécu, et dont les romans enchantèrent l'époque 1950-1960) me déclara: «Ça fait des années que j'écris pour vous et je ne le savais pas moi- même !...» Ce fut le début d'une amitié.
— Puis-je être indiscret ? Cette phrase de Roger Nimier, de quel grand auteur classique auriez-vous souhaité l’entendre ?
— J'aime les héros du théâtre elisabéthain, c'est-à-dire le temps de Shakespeare. Du reste, la première fois que le déclic du théâtre s'est produit en moi, c'est en voyant «Le Roi Lear» de Shakespeare: j'aimai le rôle d'Edmond.
— Qu'est-ce que le métier d'acteur, Ronet ?
— Surtout un comportement. Un acteur, c'est quelqu'un qui n'a aucune matière devant lui, puisque le texte, il le transforme, et il le fait sien; sinon, bien entendu, il n'y aurait que des comédiens stéréotypés. Acteur, c'est le métier du moment, de l'instant. Je dis toujours que quand un personnage m'intéresse, il faut que je balaye dans les coins, que je l'étudie jusque dans les replis cachés pour pouvoir tout donner au moment de jouer. C'est seulement comme ça que c'est intéressant.
— Revenons (une fois encore) à votre carrière. Quels films l’ont le plus marquée ?
— «Plein Soleil», de René Clément avec Alain Delon et Marie Laforêt. C'est l'histoire de la substitution d'un homme à un autre. Je jouais l'ami d'un homme, et je voulais m'approprier, tout à la fois, sa femme et son argent. Alain Delon m'y tuait comme il allait me tuer, quelques années plus tard, dans «La Piscine».
— J'avais beaucoup aimé, personnellement «La Ronde», et surtout «Trois chambres à Manhattan», avec Annie Girardot, d'après Georges Simenon. Vous formiez un beau couple et je sais que nombre de spectateurs seraient ravis de vous revoir aux côtés d'Annie. Ensuite vous avez souvent travaillé avec Chabrol. Puis, en 1965, vous vous êtes mis en scène vous- même dans «Le Voleur de Tibidabo».
— J'aime diriger un film. Bien que ce film n'ait pas eu grand succès, si aujourd'hui je pouvais choisir ma vie cinématographique, c'est bien metteur en scène que je serais, quelles que soient les satisfactions d'un acteur.
— Je vous le souhaite, et nous en reparlerons, le temps venu; en attendant vous tournez coup sur coup, en 1969 et 1970, une douzaine de films. C'est beaucoup. Votre cote monte constamment.
— Merci, mais soyons honnêtes: les films ne sont pas tous bons; mais j'estime qu'il y a pire qu'un acteur qui tourne «mal»: un acteur qui ne tourne pas du tout...
— Alors, parlons de trois films qui m'ont fortement plu, d'abord «Un peu, beaucoup, passionnément» de Robert Enrico.
— J'étais le mari qui, dans ses voyages de musicien, tombe sur une ravissante Yougoslave et l'enchaînement des faits fera que nous partirons ensemble, avec ma famille, aux Baléares. Au moment où je romps pour toujours avec ma femme, Lucienne Hamon, je ne sais pas encore que ma maîtresse m'a déjà quitté, sans espoir de retour.
— Puis «Les Femmes», écrit par Jacques Laurent et réalisé par Jean Aurel. Vous le jouez avec Brigitte Bardot.
— Là c'est un personnage, qui, à force de profiter de sa condition de célibataire, et d'accumuler les femmes autour de lui, frise la folie. A force d'être épris de ce que Jacques Laurent appelait (dans votre interview de lui, ici-même) l'indépendance, le héros tombe dans la confusion la plus totale.
— A propos d'indépendance, quelle est, dans la vie, votre attitude à l'égard des femmes?
— Elles y jouent un grand rôle, dans ma vie, et je ne m'en cache pas. Je fus marié, notez bien, avec Maria Pâcome, mais nous ne nous entendions pas. J'étais davantage attiré par la rue, que par le foyer. Nous sommes d'ailleurs, Maria et moi, restés en excellents termes. Mais enfin, je ne me suis pas remarié.
— Sans faire de phrases, nous dirons, pourtant, que les dames sont fort sensibles à votre charme.
— Ce n'est pas à moi d'en juger. Est-ce qu'un mètre 80 et des yeux bleus suffisent à leur paraître une promesse ? En tout cas, je dois surtout les intriguer: 44 ans, et non encore «casé».
— Au début de cette année, vous jouiez le rôle principal dans cette pure merveille qu'était «Raphaël ou le Débauché», de Mag Bodard et Nina Companeez. Ces couleurs ravissantes, ces chevauchés au petit matin, le jeu du chat et de la souris auquel vous vous livrez contre Françoise Fabian, le romantisme, très appuyé, de vos souffrances, tout cela nous donnait l'impression d'être à l'époque d'Alfred de Musset, et votre visage pâle, aux traits tirés, impressionnait.
— Saviez-vous, à ce propos, que Musset a écrit une plaquette qui s'appelle «Portrait d'un libertin», et que le héros y a pour nom Raphaël. Je me suis demandé s'il y avait là simple coïncidence ou si c'était voulu...
— Quels sont vos projets ?
— Je pars, bientôt, caméra en main, en Indonésie, au bout des îles de la Sonde exactement dans l'archipel des Florès, filmer le dragon du Komodo, un animal qui existait déjà . à la fin de l'ère secondaire. Il est très en arrière dans la chaîne des Espèces. Mon film sera un carnet de route, un journal de bord de la mythologie du dragon en Extrême-Orient. Je suis, tout à la fois, producteur et réalisateur. J'y rêvais depuis des années. En Occident, le dragon n'est jamais présenté que comme symbole du mal, que terrassera saint Georges. En Orient, c'est bien plus subtil. J'attends beaucoup de ce travail.
— Qu'est-ce qui vous paraît l'essentiel dans la vie, Maurice Ronet ?
— L'action, car elle implique un choix. Toute forme d'action, à partir du moment où on la choisit soi-même.
— Je me demande si les jolies spectatrices, qui avaient tant aimé «Raphaël ou le Débauché», savaient que, pour vous, aujourd'hui, l'action essentielle va être d'aller retrouver, à 15 000 kilomètres, un animal vieux de quelques millions d'années. Bon voyage, mais le public attend avec impatience «Les Galets d'Etretat».
léon Zitrone
© Jours de France № 885, 1971
Перейти к другим статьям
Cinémonde № 1231, 1958 / Ciné-Revue № 35, 1968 / Ciné-Revue № 17, 1970 / Jours de France № 885, 1971 / Le soir illustré № 2042, 1971 / Ciné-Revue № 41, 1972 / Ciné-Revue № 10, 1975 / Ciné-Revue № 10, 1979 / Alibi № 116, 1980 / Ciné-Revue № 18, 1982