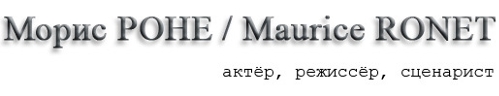L'AUTRE PASSION DE MAURICE RONET :
LES ABEILLES...

Maurice Ronet en est aujourd'hui, en moins de 20 ans, à son 60e film. Depuis le « Rendez-vous de Juillet », de Becker, il poursuit une carrière où les succès sont à la mesure de son talent. Rappelons « Les Aristocrates », « Celui qui doit mourir », « Ascenseur pour l'Echafaud », « Plein Soleil » (que l'on a revu dernièrement à la télévision), « Le Feu Follet », « Les Centurions », « Delphine », « La femme infidèle », « La Piscine », « Les femmes » et dernièrement « Raphaël ou fe débauché » et « Un peu, beaucoup, passionnément ».
Pour le public, il est un grand comédien, une grande vedette. Pour ceux qui le connaissent, il est attachant, intelligent, franc et avec lui, un dialogue prend un intérêt tout particulier. S'il est principalement et aujourd'hui presque totalement voué au cinéma, Maurice Ronet n'en est pas moins un artiste étonnamment doué et à côté des mille et un sports qu'il pratique (ski, natation, escrime, équitation, etc...) il évolue aussi dans beaucoup d'autres domaines qui le conduisent de la peinture à la musique, de la céramique à la philosophie...
— Malheureusement, on ne peut pas tout faire, regrette-t-il mélancoliquement, il faut se limiter. Après avoir tourné en 1949 « Rendez- vous de juillet », mon premier grand rôle, je me suis remis à la peinture, j'ai écrit et en réalité, je me dispersais.
— Vous ne peignez plus ?
— Plus du tout, je referai des toiles, mais pas en amateur. J'appartenais à un groupe sérieux pour qui peindre n'était pas de la blague. J'ai arrêté en 1952 ou 1953 avec une toile dans la tête. C'est celle-là que je ferai quand je recommencerai.
— Pour ce qui est d'écrire...
— J'avais écrit deux romans, de petites nouvelles, mais à partir du moment où j'ai commencé à écrire pour le cinéma, je suis resté dans ce domaine.
— Votre manière d'écrire a-t-elle été modifiée par le cinéma ?
— Si vous aviez lu le scénario de mon premier film de réalisateur « Le Voleur de Tibidabo », vous auriez remarqué un côté auteur pas fini. C'était l'époque où j'avais encore besoin de m'adresser à la littérature pour transposer sur des images. Aujourd'hui, j'ai plus tendance à écrire dans le comportement.
— Vous venez d'évoquer « Le Voleur de Tibidabo »...
— Je vous avouerai qu'il n'a pas marché. Et cela, pour beaucoup de raisons. Vous savez, ajoute Maurice avec une pointe d'ironie, on peut toujours expliquer les échecs à posteriori ! Ce fut imputable à une question de montage, parce que le film était trop long. On pronostiquait une heure et demie et, après sept semaines de tournage, sans avoir dépassé le devis (je tiens à le dire), je suis arrivé à trois heures vingt de projection ! J'avais la valeur de deux films ! Avec les impératifs de distribution qui exigent une heure quarante-cinq, parce qu'il y a un court-métrage, parce qu'il y a de la publicité, (enfin tous ces trucs qui tuent un petit peu le cinéma !), on m'a demandé de réduire mon film. Comme je ne voulais pas couper à l'intérieur des séquences, pour ne pas nuire à la compréhension de l'histoire, j'ai coupé des séquences entières. Résultat : au lieu de faire un film court et rapide de deux heures, j'ai fait un film lent d'une heure et demie.
— N'étiez-vous pas en cause en tant qu'acteur ?
— Si. Depuis le « Feu Follet » qui venait de sortir, les gens me voyaient sous un certain angle, dans un certain ton. Or, il s'agissait d'une farce, c'était la première fois que j'essayais de faire quelque chose dans la comédie... Enfin, il y a eu l'époque de la sortie, les années 65, les gens n'étaient pas tellement disponibles et le cinéma français était divisé entre deux clans. Comme je n'avais pas attendu huit ans pour que mon film tombe dans l'un de ces clans, c'est- à-dire qu'il soit apparenté soit aux anciens, soit aux nouveaux metteurs en scène, je n'ai fait aucune concession.

— Qu'ont dit les critiques ?
— Certains critiques, pas tous, ne sont pas des gens libres. Ils vont au cinéma avec des idées très arrêtées. Si on rentre dans ces idées et que l'on fait le film qu'ils attendent de vous, ça marche, sinon... Ils pensaient à une influence de Godard ou de Malle et comme mon film ne tombait pas dans ce coli- mateur, ne l'ont pas jugé intéressant. J'ai commis l'erreur de choisir un circuit de salles dont le succès dépendait beaucoup des critiques.
— N'aviez-vous pas envisagé de remonter le film ?
— Effectivement, mais je me suis dit que ce n'est pas parce que je le remonterais qu'il marcherait. J'ai alors pensé que s'il ressort, il devrait rester tel quel, à part quelques petites coupes, et peut-être rencontrera-t-il à ce moment le public. De toute manière, je suis loin de me lamenter sur quelque chose qui n'a pas été ! Ce qu'il faut c'est marcher de l'avant.
— Et pour cela on peut vous faire confiance ! Je sais d'ailleurs que cette année, vous allez réaliser un ou peut-être deux de vos rêves...
— Oui, répond Maurice en s'étirant, lorsque je suis revenu des U.S.A. il y a deux ans, après avoir tourné « How sweet it is » avec Debbie Reynolds, je suis passé par l'Asie, dans le but de faire un court-métrage, et même un long-métrage sur des animaux vivant dans les îles Commodo ! Il y a en effet dans ces îles un animal qui est le descendant des dinosaures et des brontosaures et qui a toutes les caractéristiques morphologiques. C'est un énorme lézard de 6 mètres de long et qui pèse 500 kilos.
— Personne n'a jamais rien fait sur ce sujet ?
—Si, il y a eu un film soviétique d'une demi-heure et un film japonais d'un quart d'heure. Un auteur suisse nommé Feffer a écrit un livre intitulé « Les Dragons de Commodo » et Life a envoyé des photographes qui ont pris trois photos. C'est tout. Comme j'avais l'occasion de passer par Singapore pour voir un ami, cela m'aurait permis de tourner ce film. Malheureusement, le bateau sur lequel je me trouvais a eu une avarie, nous ne sommes pas arrivés jusqu'à Commodo qui est quand même assez loin, derrière Bali, et nous nous sommes arrêtés à Djakarta. Parti pour filmer les dragons, je me suis retrouvé occupé à faire de la pêche sous-marine, ce qui m'intéressait nettement moins. Et comme je devais être rentré à Paris pour le doublage du film que j'avais tourné en Espagne « Les Oiseaux vont mourir au Pérou », j'ai dû abandonner mon projet. Le plus drôle, ou le moins drôle, c'est qu'en arrivant à Paris, Romain Gary (l'auteur du film) m'a très gentiment dit qu'il essayait par tous les moyens de joindre l'ambassadeur français à Singapore pour le prévenir que j'avais encore 10 jours ! Pourtant, c'est décidé, je tournerai ce film un jour. Notez qu'il ne s'agit pas seulement d'un film sur le dragon de Commodo. Je voudrais parler aussi du mythe du dragon en Orient et en Extrême-Orient. Cela se présenterait sous forme de documentaire zoologique sur les dragons, sans être didactique, et je voudrais qu'une espèce de parabole se dégage de ça. Voyez-vous, en Occident, le dragon est une incarnation du mal qu'il faut terrasser pour atteindre à autre chose. En Orient, le dragon incarne le mal, mais aussi le bien. Il y a en Chine quelque 10 à 12.000 dragons liés à des événements quotidiens et qui portent en eux à la fois un caractère positif et un caractère négatif, c'est- à-dire qu'il est à la fois adoré et craint. C'est cela que je voudrais montrer.
— Quant à votre second rêve ?
— Cela, c'est autre chose. Je vais faire un film autour d'un homme que j'ai rencontré et qui habite dans le mont Ventoux. C'est un apiculteur qui, à force d'avoir vécu avec les abeilles, a l'air d'être devenu physiquement une abeille ! Lorsqu'on le fait parler, on s'aperçoit qu'il a une culture spécialisée dans la vie des abeilles très étendue et quand il parle il fait sans le savoir un cours de philosophie, de morale, de sociologie et en même temps il se passe quelque chose d'assez terrifiant parce que c'est à rapprocher avec certaines choses qui nous menacent, à savoir la robotisation chez les uns, la morale violente chez les autres... J'avais pensé écrire un scénario mais je me suis rendu compte qu'au fond, ce qui est émouvant c'est de filmer cet homme tel qu'il est, sans rien changer. On commence par un reportage qui, petit à petit, devient autre chose atteignant même l'épouvante. J'ai besoin d'objectifs très spéciaux, qu'on utilise pour photographier des tableaux, qui permettent de faire un travelling sur une abeille et aussi de ce qu'on emploie en chirurgie, une espèce d'aiguille longue que l'on rentre dans le corps et qui est à la fois projecteur et appareil de prises de vues. Je voudrais simplement exposer, à travers les abeilles, ce que sera la société de demain.
— Vous vous intéressez aux animaux en général ?
— Non, je m'intéresse au cinéma !
— Et dans ce cinéma que vous aimez tant, vous écrivez, vous jouez, vous mettez en scène, en somme vous êtes tantôt d'un côté, tantôt de l'autre...
— On ne peut pas opposer le fait d'être acteur à celui d'être metteur en scène. Tous les acteurs sont un petit peu metteurs en scène à l'intérieur, comme tous les metteurs en scène sont un peu acteurs. Quant à moi, je n'ai aucune préférence. Quand j'ai commencé à faire du cinéma, on n'avait pas le choix. Il était impossible de devenir du jour au lendemain metteur en scène ! Il fallait d'abord être assistant pendant très longtemps, et ensuite premier assistant pendant trois films. J'ai commencé comme acteur avec l'idée de faire de la mise en scène et d'écrire les sujets que j'avais envie de tourner. Je ne me suis jamais mieux senti de ma vie (et pourtant j'ai fait beaucoup de choses !) que quand j'ai pu faire mon film comme acteur, auteur et metteur en scène. C'était véritablement un tout. Cela dit, je me serais très mal vu faisant la mise en scène du « Feu Follet » ou du « Scandale ». J'étais parfaitement à ma place comme acteur et n'avais aucune envie de changer. Avec Malle ou Chabrol, tout était complet.
— Avez-vous toujours fait ce que vous aviez envie de faire ?
— Alors là, qui peut dire cela ?
— Un rêve non réalisé ?
— J'aimerais tourner un film sur Cortez, comme auteur, acteur et metteur en scène et cela, depuis de nombreuses années. J'ai déjà écrit un scénario. Mais la conquête du Mexique est une histoire tellement riche que je me suis laissé aller. Résultat : pour réaliser ce que je veux faire... tout est trop cher et de plus connaissant la situation en France...
— Il y a toujours une crise du cinéma...
— ... du cinéma et de pas mal de choses. Il y a surtout un manque de capitaux. C'est bien dommage parce qu'il y a chez nous une force vive, qu'il n'y a peut-être pas en Amérique, qu'il y a peut- être en Italie et certainement en Espagne. Il ne faut jamais oublier que le cinéma est le véhicule de la pensée d'un pays et qu'à l'heure actuelle, il est plus important que la peinture, la sculpture, la littérature et même la musique et que par conséquent, il fait la réputation d'un pays !
Cependant, on a obtenu certaines réformes qui facilitent quand même les choses, ne fût-ce que les avances sur scénarios qui permettent à de jeunes réalisateurs de s'affirmer. Depuis l'affaire Langlois, il semblerait que le gouvernement et le Centre du cinéma, qui est para- g o uvernemental, s'intéressent vraiment aux choses du cinéma ? Et le jeune cinéma est beaucoup plus favorisé ici qu'en Italie ou en Allemagne. Les intentions et certaines réalisations du Centre du cinéma sont efficaces. Mais comme je vous l'ai dit, la crise est liée aux manques de capitaux et aux difficultés financières du gouvernement.
— Le théâtre ?
— La dernière pièce que j'ai jouée à Paris s'appelait « Un beau dimanche ». C'était en 1953.
— Vous n'avez plus envie ?
— Si, au contraire ! Mais je n'ai pas de pièces ! Qu'on m'en envoie ! Samuel Fuller, avec qui j'avais fait un film, avait tiré une pièce de « Choc Corridor ». Il m'a proposé de faire l'adaptation, la mise en scène et de la jouer au théâtre. Cela me passionnait mais les producteurs de théâtre à qui j'ai proposé cette pièce ont eu l'air plutôt inquiet et n'estimaient pas le moment opportun. Aussi, je reste dans l'expectative.
— Avez-vous retrouvé les gens de vos débuts ?
— De temps à autre j'ai revu des peintres, mais main tenant je ne les vois pratiquement plus. La peinture, c'est un milieu avec une mentalité très particulière, une recherche particulière, un regard sur le monde aussi très particulier et cela s'avère souvent incompatible avec tant de choses... Pourtant je suis très fidèle en amitié, mais il se trouve que la vie vous entraîne...
— Et quand vous ne travaillez pas ?
— En fait, je travaille toujours. A part cela, j'ai construit une maison, dans le Midi, exactement dans le Vaucluse...
— Vous l'avez construite vous-même ?
— Pas vraiment, sourit Maurice, mais j'ai quand même aidé à poser les pierres ! Je pense toujours à monter ou du moins à essayer de monter des tas de choses...
— Ne pensez-vous pas que les hommes de votre génération ont une tendance à trop travailler ?
— Notre génération avait une grosse qualité : la santé et une espèce de tonus qui vous maintenait en forme ! Et puisque vous parlez de ma génération, je vous dirai que dans « Un peu, beaucoup, passionnément » qui vient de sortir, j'incarne un homme de 40 ans, en pleine crise. Mis en contact avec une fille de 17 ans, il a d'un autre côté ses enfants et sa femme qui ne lui suffisent plus. Et cet homme n'accepte pas, ne supporte pas la vie telle qu'elle est. Il essaie, mais trop tard, d'en changer.
Maurice Ronet reste pensif quelques instants, puis :
— Cette génération n'était pas attendue par ceux qui nous ont suivis. Quant à ceux qui nous précédaient, ils ne nous voulaient pas. Maintenant, on y revient, on commence à se situer, à se placer. Il se trouve que les jeunes gens de 20 et 25 ans qui vont au cinéma sont de plus en plus intéressés par cette génération.
Et, me regardant dans les yeux, l'acteur conclut :
— Et au fond, les problèmes de ces jeunes qui sont quand même très mûrs par rapport à ce que nous étions à leur âge, et ceux des hommes de 40 ans qui sont encore jeunes (je parle en général, pas pour moi !) ne sont-ils pas pratiquement les mêmes ?

© Le soir illustré № 2042, 1971
Перейти к другим статьям
Cinémonde № 1231, 1958 / Ciné-Revue № 35, 1968 / Ciné-Revue № 17, 1970 / Jours de France № 885, 1971 / Le soir illustré № 2042, 1971 /Ciné-Revue № 41, 1972 / Ciné-Revue № 10, 1975 / Ciné-Revue № 10, 1979 / Alibi № 116, 1980 / Ciné-Revue № 18, 1982