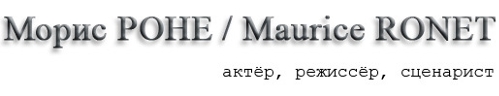Maurice RONET : «La télévision privée peut sauver le cinema!»
Cela faisait longtemps qu'on n'avait plus vu Maurice Ronet dans un grand rôle au cinéma. En effet, trop pris par ses occupations de producteur et de réalisateur de télévision, l'inoubliable interprète d'«Ascenseur pour l'échafaud», de «La dénonciation», de «La piscine» et de «La route de Corinthe», donnait l'impression de négliger quelque peu sa propre carrière d'acteur, au demeurant bien remplie... Aujourd'hui, Maurice Ronet prépare son retour à l'écran, puisqu'il partage la vedette de «La guérillera», de Pierre Kast, avec Agostina Belli et Jean-Pierre Cassel. Il s'agit d'un film d'aventures traité comme un western, un genre qui ne tentait pas particulièrement les cinéastes français jusqu'à présent. Mais ce retour au cinéma ne peut pas être considéré comme une amorce de marche arrière : fort d'une popularité qui le place en troisième position, parmi les vedettes masculines françaises, Maurice Ronet entend mener de front une quintuple carrière! Vedette du grand écran, il veut continuer à jouer pour la télévision, mais également à produire et à réaliser... Sans négliger pour autant le volet le plus récent de ses activités : celui de père de famille!

J'ai tout de suite été tenté, quand Pierre Kast m'a proposé «La guérillera», car on me propose très rarement des films d'aventures, ou à grand spectacle. Le film se présente un petit peu comme un western, mais un western léger. C'est un aspect du film qui correspond à nos souvenirs d'enfance en tant que spectateurs de cinéma. Pierre Kast, Jean-Pierre Cassel et moi-même, nous sommes tous un peu de la même génération, celle de ceux qui ont été voir un nombre incalculable de westerns quand ils étaient gosses. Donc, ce film est un petit peu une vision d'enfance. Le thème du film est très simple : des prisonniers et des géôliers qui deviennent alliés pour survivre face à l'adversité représentée par des lanciers et des pillards, est très proche du western traditionnel. Je pense que Pierre Kast a voulu démontrer que l'instinct de survie est plus forte que les idéologies... Ce qui m'a séduit dans mon personnage c'est sa truculence, qui me change complètement des personnages que j'ai l'habitude de jouer.
— Vous avez effectivement peu tourné de films d'aventures. Est-ce quelque chose qui vous manquait?
— Chaque film est une expérience nouvelle. Disons surtout que c'est un personnage que je n'avais pas l'habitude de jouer, du moins tourné sous cet angle... C'est un baroudeur, un homme seul, ce qui correspond à ce que j'ai déjà joué plus ou moins, mais il y a, en plus, cette espèce de délire d'image et d'aventure. L'aventure du tournage, en ce qui me concerne a été amplifiée par le fait que je n'ai pas tellement l'habitude de courir dans les montagnes avec un pistolet à la main!
« IL FAUT RENDRE GRACE A LA TELEVISION! »
— Votre carrière a changé depuis que vous faites de la réalisation. Est-elle plus satisfaisante qu'avant? Car vous ne tournez plus au cinéma de grands rôles comme celui que vous teniez dans «Raphaël ou le débauché».
— Je crois qu'il y a un moment où chaque acteur passe un cap. Je vieillis comme tout le monde et j'ai passé l'âge de jouer le personnage plus ou moins fragile que j'étais. Mais le changement s'est effectué sans que j'y fasse attention étant donné qu'effectivement je fais de la réalisation, j'écris, et je suis producteur de télévision. Donc je n'ai pas vu passer ce tournant fatidique que tous les acteurs sentent arriver à un certain moment. Il faut dire aussi que j'ai tourné énormément et que, pendant quatre années, j'ai moins pensé à l'acteur Maurice Ronet. Je n'étais pas à l'affût d'un rôle, j'étais à l'affût de l'aventure cinématograhique. D'ailleurs j'ai toujours voulu mener ma carrière cinématograhique sur tous les fronts. J’ai toujours voulu mener cette aventure dans toutes les directions que m'offrait l'éventail cinématographique, puisque je suis même parti deux fois à l'autre bout du monde pour tourner des reportages. Je ne suis pas un carriériste, je crois qu'à une certaine époque j'ai trop tourné et souvent un peu n'importe quoi. J'ai tourné des films qui n'ont pas très bien marché. Un acteur plus averti aurait été plus difficile. J'ai accepté beaucoup de films simplement parce que j'y trouvais mon compte dans l'imaginaire, mais je n'aurais pas du me contenter de si peu : j'aurais du être plus exigeant vis-à-vis des scénarios qu'on me proposait.
— Mais vous vous en êtes expliqué à l'époque, en disant que l'important, pour vous, était de jouer.
— Oui, je disais et je dis toujours qu'il vaut mieux tourner mal que de ne pas tourner du tout, mais je crois que j'ai été un petit peu loin dans ce raisonnement. Bref, je n'ai pas vu passer ce cap, car j'ai réalisé plusieurs films pour la télévision. J'ai écrit d'autres scénarios que je m'efforce de monter, mais cela a du mal à aboutir parce que je vais à contre- courant. Les producteurs et les distributeurs ont leur propre notion de rentabilité : il faut que cela rapporte de l'argent tout de suite. Ils ont raison, d'ailleurs, puisque le cinéma est aussi une industrie. Mais ce ne sont pas des « risque-tout » : ils aiment bien les «mines» et détestent les prototypes. Mais, en réalité, il n'y a que les prototypes qui marchent.
— Est-ce pour cette raison que vous avez essentiellement réalisé des films mis en scène pour la télévision, qui n'a pas les mêmes critères de rentabilité?
— Oui, il faut même rendre grâce à la télévision de permettre la réalisation de certains films qui n'auraient aucune chance de voir le jour au cinéma. Et c'est vrai aussi pour les personnages : je viens de terminer un personnage pour la télévision et je vais en commencer un autre, deux rôles absolument fascinants qui feraient très bien des films. Le téléfilm que je viens de tourner pour Frank Apprédéris, avec Mimsy Farmer, «La déchirure», a été fait avec autant de soin qu'un film de cinéma.
« J'AIME TRAVAILLER AVEC DES PROFESSIONNELS! »
— N'avez-vous jamais ressenti le manque de moyens en tant que réalisateur, à la télévision?
— Ah mais pas du tout! Et j'ai toujours fait ce que je voulais! Je n'ai jamais vu arriver un directeur de production pour me dire que cela n'allait pas. J'ai toujours eu une paix royale! Je peux donc dire que si ma vie professionnelle est plus complète aujourd'hui, elle est aussi plus difficile. Parce que c'est difficile de trouver des capitaux, de convaincre. Or c'est une chose que je n'ai jamais très bien su faire. C'est très difficile de parler de soi en disant : «Vous allez voir ce que vous allez voir!» Je ne sais pas me vendre. Si on me fait un peu confiance, je sais partir dans la direction de cette confiance et même au-delà. C'est quelque chose qui rend les contacts difficiles à la télévision et insurmontables au cinéma. C'est fou, on y laisse sa santé! Souvent, on monte une affaire pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le scénario, on monte un film parce que les gens ont besoin de devises étrangères. C'est vraiment du coup par coup en Europe, cela ne se passe pas du tout comme aux Etats-Unis où il y a des gens compétents qui savent juger un scénario. Parce qu'un scénario c'est fait de bric et de broc, c'est un intermédiaire entre l'auteur et le film. Il faut savoir le lire et il y a très peu de gens qui savent. La plupart des producteurs restent les pieds sous la table, c'est pour cette raison que je suis devenu producteur. Ils attendent que vous leur apportiez le scénario, le distributeur, l'avance sur recettes si c'est possible, une co-production qui a de l'argent, des apports privés. Et puis, les trois quarts du temps ils vous demandent en plus de mettre votre cachet en participation! Tout ce qu'ils risquent, dans ces conditions, c'est de ne rien gagner. A ma connaissance, il n'y a que la Gaumont qui investit réellement des capitaux dans un film. Il faut remercier la Gaumont d'être ce qu'elle est et lui tirer son chapeau. Ce travail est fait par des gens que l'on critique parce qu'il est de bon ton de critiquer les gens qui réussissent à faire quelque chose dans la vie, surtout en France. Mais il ne faut pas oublier que ce sont eux qui défendent les couleurs du cinéma français à l'étranger, y compris aux Etats-Unis.
— Vous avez tourné «Le sphinx» l'année dernière, avec les Américains. Est-ce important, pour vous, de travailler aussi à l'étranger?
— J'aime bien tourner avec les Américains parce que ce sont des professionnels, des gens qui connaissent leur métier. C'est un film qui a duré quatorze semaines, ce qui est absolument impensable en France, sauf si on le fait avec la télévision. C'est pensable de la part de Claude Lelouch quand il fait «Les uns et les autres» ou de la part de Robert Hossein quand il fait «Les misérables». Seulement il faudrait aller de plus en plus dans ce sens, c'est-à-dire vers des accords de production entre la télévision et le cinéma. Il ne faut pas mépriser la télévision, ce qu'on a un peu tendance à faire à l'heure actuelle. D'une part parce qu'elle représente un public potentiel énorme et d'autre part parce que le cinéma est pauvre en France. «Duel» le film de Steven Spielberg était à l'origine un téléfilm. Et puis ce téléfilm est sorti au cinéma et Steven Spielberg est devenu ce qu'il est! En France, une telle chose semble complètement impensable. En Amérique il y a cette télévision privée qui rapporte un argent fou et qui dispose donc de moyens énormes. En France, il nous faudrait au moins une ou deux chaînes privées. Seulement, les gouvernements, avec le peu d'argent dont ils disposent, hésitent à entrer en compétition avec une télévision qui diffuserait de la publicité et qui serait par conséquent plus riche que la chaîne nationale.
« GARY COOPER : UN ETRE FASCINANT! »
— L'échange entre le cinéma et la télévision existe-t-il vraiment en France?
— Non, nous sommes au point mort. D'ailleurs tout stagne en ce moment... Robert Hossein tourne actuellement «Les misérables», c'est formidable mais, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'autres exemples à citer. Je pense qu'il s'agit là d'une association qui va se faire toute seule, quelle que soit l'économie dans laquelle on se trouve. Il va bien falloir passer par là si l'on veut que le cinéma français continue à exister. Aujourd'hui, on ne fait pas un film à moins de quatre cents millions d'anciens francs. Or on ne trouve pas facilement une telle somme. On fait des tas de reproches à la Gaumont, mais heureusement qu'elle existe! Sinon, il n'y aurait rien du tout. Il faut dire qu'en France on a malheureusement l'habitude de couper les têtes qui dépassent!
— Vous évoquiez tout à l'heure votre passion pour le western, quand vous étiez adolescent. Avez-vous eu à l'époque des idoles, comme Gary Cooper par exemple?
— Absolument! Plus tard, j'ai eu la chance de le connaître lorsque j'ai débuté. C'était un être absolument à part, mystérieux, qui déplaçait autour de lui une espèce de grâce. On ne peut même pas parler de talent, ni de quoi que ce soit, c'était un personnage à part. D'ailleurs sa vie est très fascinante et passionnante. Gary Cooper a été évidemment une de mes idoles d'enfance, comme Cary Grant, pour d'autres raisons. J'ai vu au moins trente fois «Une aventure de Buffalo Bill»! A l'époque, il y avait toujours deux films au programme, pratiquement pas d'entracte, des actualités, puis un vieux film et un nouveau. Et lorsqu'on arrivait au changement de programme, le mercredi, on pouvait voir quatre films pour le même prix! Je n'allais au cinéma que le mercredi, vous pensez... pour le même prix j'en avais quatre! Le cinéma, c'était de la folie pour moi. Bien que mes parents fussent acteurs, ils me reprochaient d'aller trop souvent au cinéma! Chaque fois que j'avais une heure de libre et que je passais devant un cinéma, j'entrais pour voir une heure de film, et cela m'arrive encore. Quand je vais au cinéma, je ne vais pas voir un film: j'en vois quatre dans la journée!
— Le fait d'être devenu professionnel n'a-t-il pas changé votre regard?
— On dit, souvent : «Vous êtes du métier, donc vous voyez des défauts oue les autres ne voient pas». Je ne crois pas. En fait, on ne voit pas autre chose que ce que voit le public. Quand j'entre dans une salle, je suis complètement spectateur. D'ailleurs je ne vois pas comment je pourrais ne pas l'être. Je suis spectateur avec une espèce d'habitude et d'exacerbation de ma sensibilité par rapport au cinéma, mais pas plus qu'un type qui voit quatre cents films par an. A propos des deux films que nous avions à l'époque à chaque séance, je pense qu'on pourrait essayer d'avoir un petit peu moins d'entracte et un peu plus de cinéma. Ce sont les esquimaux qui tuent le cinéma!

«JEAN SEBERG ETAIT MANIPULEE!»
— Vous avez tourné «Les oiseaux vont mourir au Pérou» avec Jean Seberg et Romain Gary. Que pensez-vous du destin tragique de ces deux artistes?
— J’ai tourné quatre films avec Jean Seberg : «Les grandes personnes», puis «La ligne de démarcation», «La route de Corinthe» et enfin «Les oiseaux vont mourir au Pérou». Quelqu'un qui se suicide, c'est toujours au bout d'un certain compte, j’ai été bouleversé. J’avais rencontré Romain quelques jours auparavant. Quant à Jean, nous avions passé toute une journée ensemble, deux mois avant sa mort. Je l'avais sentie complètement désesperee et au bout du rouleau. Son geste etait-il prévisible? Sûrement pas. Sinon, je ne l'aurais pas laissee partir. J’avais enormement d'amitié, de tendresse et d'affection pour elle. Je l'aimais beaucoup. Nous étions très liés, mais sans aucune équivoque. Nous nous amusions beaucoup ensemble. Jean voulait absolument faire quelque chose d'important et puis elle a été propulsée dans l'univers cinématographique... L'influence d'Otto Preminger sur elle a stoppé sa croissance à un certain moment. Elle faisait très bien ce métier, mais je crois qu'elle n'était pas tout à fait faite pour le cinéma. Elle n'était pas assez solide pour encaisser les coups. Elle avait vraiment envie d'être autre chose que ce quelle était. C'est la raison pour laquelle elle s'est laissée embarquer dans des histoires vaguement politiques. Je pense qu'elle était dans les mains de gens qui la manipulaient.
— Donc, un metteur en scène peut avoir une influence très importante sur une comédienne...
— Sur une fille de dix-sept ans, oui, et comment! Une fille de dix-sept ans qui découvre à la fois le cinéma, Otto Preminger et Jeanne d'Arc, il faut qu'elle soit armée! Or Jean Seberq était très sensible et vulnérable. Ceci dit, son suicide est complètement inexplicable pour moi. Si on m'avait dit qu'elle s'était jetée du haut d'un pont ou qu'elle s'était logée une balle dans la tète, j'aurais compris, mais je ne vois pas comment elle a pu s'installer à l'arrière d'une voiture, mettre une couverture sur elle, prendre des barbituriques et s'endormir la-dessus... Cela ne lui ressemble pas tellement. Cette mort est une fin bizarre, il y a mille manières de mourir dans la rue, sans cette mise en scène un peu curieuse.
«LA SEDUCTION EST UN STYLE!»
— Dans une récente enquête, parue dans un hebdomadaire vous arrivez en troisième position dans le cœur des Françaises...
— Oui, cela m'a surpris, j'en suis ravi, mais ce qui est amusant, c'est qu'elles n'ont pas su dire pourquoi. En tout cas cela n'est pas désagréable, il vaut mieux lire ça qu'entendre dire : «Il est à jeter par la fenêtre!» Flatté, n'est peut-être pas le mot mais cela m'a fait plaisir et m'a rassuré. Cela m'a prouvé que je n'étais pas oublié, malgré mon absence des écrans de cinéma. Car, à cette époque, je ne me posais de questions sur mon sort en tant qu'acteur puisque je me consacrais totalement à la production et à la réalisation...
— Etes-vous agacé lorsqu'on vous présente encore comme un jeune premier?
— Non, jeune et premier sont deux adjectifs qui ne sont pas du tout infamants. «Jeune premier» est une curieuse expression qui a traversé les époques, mais en réalité un jeune premier c'est un acteur qui est encore plus jeune que Patrick Dewaere! Il est toujours agréable de séduire. Le cinéma est une entreprise de séduction, il faut fasciner. En disant cela on a l'impression que la séduction c'est presque un métier, en fait c'est le contraire. Si on séduit malgré soi, c'est parce qu'on apporte une certaine sensibilité, une certaine personnalité, parce qu'on a un impact sur le public. C’est un style, la séduction! C'est le résultat de quelque chose.
— Avez-vous joué de cette séduction avec les femmes?
— Les trois quarts du temps, quand je l'ai voulu, cela n'a pas marché. Quand je cherchais à plaire je ratais mon coup et c'est généralement quand je ne faisais aucun effort que les choses se faisaient.
— On a pu vous voir en photo, récemment avec votre tout jeune fils... Vous, qui vous défendiez d'avoir la fibre paternelle, êtes-vous devenu un père de famille modèle?
— Non, pas du tout. Il faudra lui demander quand il sera plus âgé, mais je ne pense pas être un père de famille modèle. Je suis complètement dépassé par la situation, étant donné que c'est mon premier enfant et que j'ai trop attendu pour devenir père, je me suis presque fait un petit-fils. D'ailleurs je dis toujours à Joséphine, ma femme, qu'elle m'a fait un enfant dans le dos. Je n'ai pas changé d'opinion, je suis toujours convaincu que le père doit être une espèce de catalyseur autour duquel les choses s'organisent. Je ne pense pas qu'on ait arrangé quoi que ce soit, en créant les «nouveaux pères»! Cest- a-dire des pères qui font la cuisine et qui langent le gosse. Moi, je ne sais pas comment on fait, j'aurais peur de le casser! Non, je suis décidément un... ancien père!
Bernard ALES
© Ciné-Revue № 18, 1982
Перейти к другим статьям
Cinémonde № 1231, 1958 / Ciné-Revue № 35, 1968 / Ciné-Revue № 17, 1970 / Jours de France № 885, 1971 / Le soir illustré № 2042, 1971 /Ciné-Revue № 41, 1972 / Ciné-Revue № 10, 1975 / Ciné-Revue № 10, 1979 / Alibi № 116, 1980 / Ciné-Revue № 18, 1982